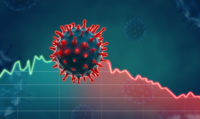Covid-19 : Qui va payer ?
Au fur et à mesure que se desserre la menace sanitaire du Covid-19, au moins pour les principales nations économiquement développées, les questions de la relance économique et de la résorption des grands déséquilibres budgétaires reviennent à l’avant-scène des préoccupations et des politiques. Sur qui pèsera le coût des efforts immenses déjà consentis : les consommateurs, les citoyens, les entreprises ou les Etats ? Le processus est encore en gestation. Il sera dans tous les cas influencé par plusieurs données contextuelles qui se précisent.
Contrairement à ce que certains avaient imaginé -ou espéré-, le « monde d’après » ne sera pas fondamentalement différent de celui d’avant la pandémie : les changements majeurs concerneront des tendances lourdes préexistantes, telles par exemple la montée en puissance des énergies renouvelables, de l’intelligence artificielle ou de la vente par internet, et la persistance de la crise pour les secteurs les plus touchés par celle-ci, et qui doivent être « reconçus », tels l’hôtellerie ou l’aviation. Pour le reste, le système économique et financier mondial devrait être peu différent de ce qu’il était, piloté pour l’essentiel par la recherche du profit maximal et la course effrénée à l’innovation, même si l’utilité globale de celle-ci n’est pas toujours évidente. En revanche, l’environnement devrait être marqué par un retour en force du rôle des Etats à deux niveaux : un plus grand interventionnisme économique dans chaque pays et le renforcement d’alliances régionales.
En second lieu, le rattrapage de la chute du Produit Intérieur Brut (PIB) subie en 2020 – -3,5 % aux Etats-Unis et -7,5 % en Europe – devrait être plus long que prévu malgré la progression rapide de la vaccination : le retour aux données de fin 2019 est désormais plutôt prévu pour la mi-2022 que pour fin 2021. Encore ce scénario peut-il paraître optimiste pour trois raisons : la relance est souvent handicapée par des retards dans les délais d’approvisionnement des entreprises en matières premières ou semifinies ; la reconstitution des équipes s’avère souvent difficile et provoque des déficits de personnel et des décalages dans la remontée en puissance des entreprises ; la menace du Covid-19 demeure présente et pourrait encore être pénalisante.
Le retour à la croissance est aussi en partie dépendant des politiques monétaires suivies par les pays concernés. Or, aux Etats-Unis comme en Europe, la situation demeure caractérisée par des taux d’intérêt fort bas -voire nuls ou même négatifs- et de très larges facilités de refinancement offertes par les Banques Centrales, en particulier pour les emprunts émis par les gouvernements pour la couverture de leurs dépenses. Ces emprunts sont en conséquence souscrits sans risque, notamment par les grandes banques, qui peuvent reconstituer aisément leurs ressources à tout moment, et souvent avec profit. Lancé pour répondre à la crise économique et financière des années 2007/2008, ce système est en place quasiment sans interruption depuis cette époque. Les liquidités peu onéreuses ainsi injectées expliquent d’ailleurs pourquoi les bourses américaines et européennes ont poursuivi sur la décennie une évolution partiellement déconnectée avec la sphère réelle et se sont vite rétablies, après le plongeon de février 2020, dépassant leur niveau d’«avant-Covid». L’inquiétude des investisseurs devant les signes d’une possible remontée des taux montre bien le rôle de cet environnement monétaire avantageux. Son abandon pourrait être synonyme de nouvelles perturbations dans les économies matures.
Dans le retour à la normale escompté, les premières préoccupations vont être de ramener dans des limites plus strictes les déficits budgétaires massifs tolérés depuis 2020 et de reconstituer la rentabilité et la trésorerie des entreprises durement touchées par la crise. Le redémarrage de la plupart des secteurs économiques et l’existence dans ces pays du Nord d’une masse importante d’épargne des ménages, qui accroit la demande à court terme, sont des facteurs essentiels pour soutenir la croissance en 2021 et 2022. Celle-ci pourrait alors mécaniquement contribuer à l’atteinte des objectifs majeurs : la poussée du Produit Intérieur Brut gonflera les recettes fiscales alors que les dépenses publiques exceptionnelles vont être réduites ; le chiffre d’affaires et les profits des entreprises augmenteront également. Ces éléments prendront cependant du temps, notamment pour ce qui concerne la situation des Etats. Ils risquent aussi de ne pas suffire et d’être accompagnés de deux ajustements simultanés.
Le premier est l’augmentation de la fiscalité. Inhabituellement, le mouvement est venu d’Outre -Atlantique à partir des orientations fixées par le nouveau Président Joe Biden. Arrivé au pouvoir en pleine crise Covid, il a changé radicalement la politique suivie par Donald Trump et a annoncé clairement une hausse des impôts, principalement sur les bénéfices des grandes entreprises et sur les revenus des classes de contribuables les plus riches, essentiellement pour financer un programme de grande envergure des investissements publics. En Europe, où le discours politique récent est resté longtemps hostile à l’alourdissement de la fiscalité, la réorientation est moins affirmée jusqu’ici en raison des retards et des incertitudes qui subsistent sur les plans de relance. La hausse de l’impôt sur les bénéfices, qui suivrait une tendance générale, l’élimination de niches fiscales, l’imposition d’avantages sociaux récemment exonérés sont cependant probables, mais d’autres hausses pourraient avoir lieu pour financer les multiples nouveaux chantiers. Outre ces mouvements propres aux Etats, on note aussi une adhésion collective en faveur d’une hausse de la fiscalité sur les acteurs mondiaux qui ont joué jusqu’ici de la concurrence entre Etats pour échapper au maximum au paiement d’impôts. Les récentes décisions du G7 sur la création d’une taxe d’au moins 15% des bénéfices des plus grandes entreprises internationales partout où elles sont présentes et l’accord européen sur une imposition minimale des GAFA, négociée depuis longtemps, marquent un « changement de pied » dans l’attitude des grandes puissances. Cette approche à l’unisson doit sans doute beaucoup au constat d’une recrudescence des inégalités lors de la pandémie Covid et d’un rejet de l’appropriation individuelle -par quelques sociétés et même quelques individus – de profits gigantesques amassés sans contrepartie équitable et parfois grâce à de l’argent public, comme le financement de la recherche de vaccins. Même si l’application pratique de ces changements se heurte à de nombreuses difficultés et exceptions, le renforcement du poids des Etats et des groupements régionaux face à une mondialisation à outrance et à la prééminence sans retenue des plus grands acteurs économiques devrait être durable. Dans ce nouveau contexte, les Etats traditionnellement les plus dépensiers devront cependant être capables de consacrer ces ressources nouvelles aux investissements publics, souvent en retard, et de resserrer leurs dépenses courantes. La France par exemple, qui a été une des nations les plus généreuses dans la phase Covid, aura fort à faire pour stopper des aides et subventions qui pourraient apparaitre comme des « droits acquis ».
Le second est le retour de l’inflation. Celle-ci connait deux principales stimulations déjà à l’œuvre : les hausses de prix de nombreuses matières premières et produits semi-finis issues de la désorganisation des circuits commerciaux en raison des contraintes sanitaires de la période qui s’achève ; les difficultés de recrutement dans divers secteurs, dans les grandes comme les petites sociétés, après des mois de fonctionnement ralenti ayant fait fuir une partie des personnels, et des politiques généreuses de paiement du chômage partiel. La hausse des prix suit ainsi déjà un rythme annuel de 5% aux Etats-Unis. Beaucoup espèrent que cette poussée sera momentanée et prendra fin avec la période d’ajustement en cours sans déclencher la spirale oubliée des augmentations de prix et de salaires. La tendance pourrait cependant être durable et plus soutenue dans certains cas : stratégies agressives des Etats pour le rapatriement d’activités pouvant conduire à la montée de prix de produits auparavant fabriqués à l’étranger ; reconstitution trop rapide de marges dans certains secteurs, ..La vigilance des banques Centrales, la nervosité des bourses montrent que le risque n’est pas si éloigné. S’il se concrétisait, la hausse des taux d’intérêts qui en résulterait pourrait entraver la croissance réelle de l’économie et placer les Etats endettés dans une possible nouvelle crise financière. Si les Autorités monétaires annoncent à moyen terme une diminution de la politique du rachat systématique de titres (quantitative easing) et une remontée modeste des taux d’intérêt, ces avertissements sont exprimés avec prudence pour limiter les inquiétudes et il n’est pas certain que beaucoup d’entreprises s’y préparent. Pour l’heure, l’hypothèse centrale est encore celle d’un accroissement modéré et durable des hausses de prix, mais celle-ci semble contredite par les faits et sera d’autant plus difficile à atteindre que les Etats tarderont à cesser leurs soutiens aux entreprises. Or, ce comportement d’Etat-providence reste encore très présent, pour éviter toute crise sociale et par suite des incertitudes sur le rebond du péril sanitaire à l’automne.
Malgré l’énormité des déséquilibres et inégalités creusés en 18 mois, le climat global est étonnamment optimiste sur le retour à une situation apaisée de croissance économique retrouvée et d’équilibres macroéconomiques reconstitués. Il est vrai que la résilience montrée par les économies occidentales, au prix de nombreuses souffrances individuelles et d’initiatives publiques inusitées, aidée aussi par la solution vaccinale, rassure dirigeants et citoyens. Les solutions extrémistes remises en avant au plus fort de la crise sanitaire, comme l’annulation de la dette publique déjà refinancée par les Banques Centrales et dans le portefeuille de celles-ci, ne sont plus guère évoquées. Il semble malgré tout difficile d’éviter que le grand « chambardement » que nous venons de vivre, dont l’extension mondiale rappelle par certains aspects la crise de 1929 ou les deux dernières guerres mondiales, ne génère pas des ajustements fiscaux ou inflationnistes d’une certaine ampleur. Ceux-ci pourraient toutefois être acceptables s’ils permettaient d’introduire dans les sociétés « avancées » plus de justice, plus de solidarité et plus de responsabilité vis-à-vis du futur. Une telle ambition serait en particulier de nature à mobiliser fortement une jeunesse inquiète devant les maigres perspectives qui lui sont ouvertes.
Paul Derreumaux
Article publié le 30/06/2021