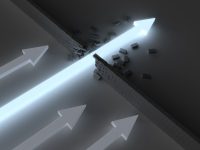Quels instruments pour préserver les bénéfices de l’intégration financière dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ?
L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) est sans doute l’exemple le plus original et le mieux abouti d’intégration régionale en Afrique. Elle est aussi un modèle qui inspire souvent d’autres initiatives de renforcement d’une coopération économique, comme l’East African Communaity (EAC) en zone anglophone. Même si les résultats actuels de l’UEMOA restent imparfaits, les avantages apportés par cette association plus que cinquantenaire sont en effet suffisamment nombreux, tant en économie qu’en politique, pour qu’un renforcement de cette union soit activement encouragé, par les Autorités des pays concernés comme par les principaux partenaires financiers de l’Afrique.
C’est sans doute dans le domaine financier, et particulièrement bancaire, que l’UEMOA est la plus en avance et que cette réussite a apporté jusqu’ici le plus de résultats positifs. Pourtant, le séisme provoqué par la crise financière internationale de 2008, puis l’ébranlement de l’Euro et la fragilisation des puissantes banques européennes inquiète. Et si le renforcement constaté de l’intégration financière de l’UEMOA facilitait les risques de crise ? Comment dans ce cas réduire au maximum les possibles contagions et éviter un danger « systémique » par une résolution rapide des difficultés apparues ?
Un rappel parait utile au préalable. L’Afrique francophone, de l’Ouest comme du Centre, a déjà connu une crise bancaire systémique dans les années 1980. Elle est née de l’accumulation simultanée d’une série de difficultés touchant une grande partie des établissements de l’époque : portefeuille sinistré et mauvaise gestion pour les banques d’Etat, difficultés majeures sur les activités exportatrices qui représentaient une part essentielle de leur chiffre d’affaires pour les banques françaises. L’origine a donc été tant bancaire qu’économique, mais la propagation à tout le système financier s’est faite alors même que celui-ci était alors peu intégré. De nombreuses conséquences ont résulté de ce cataclysme : au passif, d’importants dépôts bloqués et non remboursés à ce jour à leurs détenteurs et de graves insuffisances momentanées de financement des économies par des banques affaiblies et prudentes à l’excès ; à l’actif, l’apparition de banques africaines privées, totalement inconnues auparavant, la construction de réseaux régionaux, le retour à la bonne santé financière du secteur, une profonde transformation et modernisation de la régulation et un renforcement de la supervision devenue régionale. Sur ce dernier point, l’UEMOA est donc en nette avance sur l’Union Européenne puisque la présence d’une Banque Centrale unique munie des pouvoirs nécessaires pour un contrôle globalisé de tous les établissements de l’Union est une réalité depuis 25 ans. Ces diverses mutations ont aussi des effets positifs sur la bancarisation des populations, les possibilités de financement des entreprises, et donc la croissance économique de la zone.
Si l’intégration financière est ainsi devenue réalité et facteur incontestable de progrès dans l’UEMOA, les excès qui la caractérisent dans les pays du Nord semblent pour l’instant peu présents dans la zone. Protégées par une réglementation sévère sur les placements à l’étranger autant que par leur petite taille et leur faible expérience, les banques de l’Union n’ont jamais été infectées par les actifs toxiques qui ont semé la panique aux Etats-Unis et en Europe en fin des années 2000. Les flux interbancaires, dont le tarissement a récemment menacé le blocage du système bancaire en Europe, sont encore très limités dans l’Union, surtout entre groupes distincts, en raison de la méfiance des banques entre elles et de la bonne liquidité générale du système. Pourtant, d’autres risques potentiels, générés par l’évolution des systèmes bancaires et de leur environnement, se manifestent et parfois grandissent. Trois au moins méritent l’attention.
Le premier est celui de la qualité et du caractère approprié de la réglementation régissant l’activité bancaire, et présente donc un aspect micro-prudentiel. Le dispositif de régulation est en effet le meilleur garant du maintien de la bonne santé retrouvée et de la solidité des établissements de la zone. En la matière, les règles applicables dans l’Union ne paraissent pas avoir connu toutes les transformations souhaitables, même si plusieurs vagues de mise à niveau – et de durcissement – ont eu lieu notamment entre 1990 et 2000. La comparaison avec d’autres systèmes subsahariens comparables met d’abord notamment en valeur divers décalages en termes de ratios. Celui du capital minimal, maintenant fixé à 5 milliards de FCFA, soit 7,5 millions d’Euros, nous place derrière la majorité des pays africains. Celui du ratio de solvabilité « largo sensu », essentiel au vu des principes de Bâle II, demeure à 8% alors qu’il atteint 12% dans les pays de l’EAC. Celui relatif à la concentration des crédits limite toujours à 75% des fonds propres les concours les plus importants sur un seul risque alors que ce pourcentage est classiquement contenu entre 25% et 35% d’Accra à Madagascar. Enfin, il n’existe aucun ratio proprement dit de liquidité alors qu’un pourcentage fonds propres/dépôts de 8% doit être strictement respecté au Kenya et constitue une contrainte fort lourde. L’évolution vers des normes plus proches de celles appliquées au plan international est donc souhaitable.
Parallèlement, les méthodes de supervision gagneraient à quelques changements qui renforceraient les contrôles existants tout en instaurant des rapports plus étroits et constructifs avec les banques de la zone. Une surveillance plus serrée du respect des principaux aspects de la réglementation serait en effet facilement admise dès lors que les conclusions mettent aussi en valeur les progrès accomplis sur des bases faciles à apprécier comme celle de l’indicateur « CAMEL » dans l’EAC. La présentation obligatoire des conclusions des rapports d’inspection au Conseil d’administration des banques, déjà pratiqué ailleurs, serait aussi un utile enrichissement.
Le second risque vient des banques elles-mêmes et de leur environnement. Les récentes crises politiques de Côte d’Ivoire et du Mali ont montré la possibilité concrète de dangers tels qu’une fermeture provisoire mais totale d’établissements, des tentatives de non-respect de la légalité par certaines Autorités ou des destructions d’agences dans des régions ou villes en guerre. La prévalence dans chaque pays de la zone de systèmes économiques peu diversifiés et dominés par des cultures de rente ou des productions minières exportées et très dépendantes de cours internationaux volatils fragilise aussi les établissements bancaires : leur financement s’effectue en outre de manière plus intégrée, ce qui renforce le danger de mouvements procycliques. Le maintien d’une forte présence de sociétés étatiques, les graves dysfonctionnements des juridictions locales génèrent souvent d’autres difficultés. L’augmentation de plus en plus vive des crédits à la clientèle provoque immanquablement une diminution potentielle de la qualité du portefeuille des banques, qui tend à se vérifier dans un nombre croissant d’établissements. Des bulles financières peuvent apparaitre, comme celle de l’immobilier qui guette dans certains pays, menaçant la valeur des garanties et les remboursements des crédits. Enfin, les banques marocaines ou nigérianes, dont les réseaux multi-Etats de filiales représentent désormais plus de 50% du système bancaire de la zone, peuvent être amenées à prendre des décisions de gestion ou d’affectation des résultats de ces filiales qui tiennent davantage compte de leurs propres pratiques et préoccupations que de celles de leurs filiales.
Même si ces risques restent jusqu’ici modérés grâce à la conjoncture ou ont été gérés sans dommage excessif lors des crises politico-militaires rencontrées, quelques mesures préventives seraient opportunes. Les plus importantes devraient concerner la protection des dépôts, pour éviter le retour à la situation des années 1980 : en la matière, la mise en place d’une assurance couvrant tous les dépôts bancaires inférieurs à un plafond donné, financée par la profession, offrirait une sécurité très supérieure à celle donnée par les Etats, précédemment défaillants. Cette mesure, appliquée de plus en plus généralement à la suite de la dernière crise internationale, a reçu un début de concrétisation en mars 2014 dans l’Union et serait aussi de nature à favoriser la bancarisation. La réalisation d’inspections conjointes par les banques centrales des pays des sociétés mères et des sociétés filiales jettera les bases d’un contrôle consolidé capable de cerner au mieux et de façon équitable les intérêts de toutes les parties. Enfin, il pourrait être envisagé l’introduction de ratios variables selon divers critères, telles les caractéristiques de la conjoncture, pour introduire une composante macro-prudentielle dans la réglementation. Ainsi, le ratio de solvabilité pourrait-il être modifié selon les spécificités du bilan des établissements ou la part du résultat affectée au dividende être limitée en cas de progression inquiétante des crédits en difficulté. La responsabilité publique qui incombe aux banques dans la gestion des dépôts du public peut justifier de telles contraintes dès lors que sont réunies deux conditions : la bonne qualité des informations sur lesquelles seront fondées les décisions, sur la base de « stress tests » pertinents par exemple, et la vitesse de réaction de la Banque Centrale autorisant l’annulation rapide de décisions contraignantes en cas de retournement positif de situation.
Un troisième risque provient de l’endettement en croissance rapide des Etats. A partir de 1996, le recours à la Banque Centrale pour le financement des déficits budgétaires a été stoppé pour les Etats. Ceux-ci se sont alors tournés de plus en plus massivement vers le nouveau marché financier régional pour financer leurs besoins à court comme à moyen terme. La bourse régionale, expérience unique au monde, s’est en effet vite révélée en manque d’opportunités d’investissements, par suite de la rareté des privatisations par ce canal et de la frilosité des entreprises par rapport à cet instrument, face à une offre abondante de capitaux provenant initialement des banques et investisseurs institutionnels. Les emprunts d’Etat, bien rémunérés et défiscalisés, ont donc aisément trouvé des preneurs et ils constituent maintenant une forte majorité du portefeuille obligataire sur le marché et un pourcentage important des placements en trésorerie de la plupart des banques. Ces appels au marché se généralisent – seul le Niger reste à l’écart pour l’instant – et leurs montants respectifs comme leur nombre s’amplifient régulièrement avec les besoins croissants des pouvoirs publics.
Cette évolution génère plusieurs dangers potentiels. Elle pourrait rapidement assécher le marché alors que celui-ci était initialement destiné au financement à long terme des entreprises. Elle s’effectue par ailleurs en dehors d’une coordination optimale de ces émissions qui permettrait de rationaliser le marché. Enfin, les critères selon lesquels sont autorisés ces emprunts à moyen terme normalement destinés à des investissements bancables ne sont pas définis avec la même rigueur et la même uniformité que celle qui prévalait lors de la mobilisation de capitaux dans le cadre de l’article 16 du traité de l’Union. Avec les difficultés potentielles, économique et politique, que pourraient connaitre certains Etats, une affectation à des fins autres que celles d’investissements n’est donc pas exclue tout comme un risque de défaut, même temporaire, qui fragiliserait tout l’édifice bousier régional désormais en expansion. Pour remédier à ces risques, une gradation des mesures est envisageable. La plus facile et immédiate est celle d’une coordination et d’une programmation régionales des émissions de titres publics, pour faciliter l’absorption de ceux-ci par le marché et éviter de mettre en difficulté les émissions privées qu’il est souhaité développer : la Banque Centrale a déjà entrepris ce travail avec la création de l’Agence-Titres UMOA en 2013. La fixation de critères régionaux uniformes pour ces appels au marché financier permettrait aussi de fixer des limites acceptables par tous et aptes à mieux sécuriser le marché. Enfin, l’adoption de nouvelles règles relatives à cette composante des actifs bancaires, en termes de possibilités de refinancement par la Banque Centrale ou de plafonds en pourcentage du bilan par exemple, constitueraient aussi d’utiles garde-fous.
Les quelques risques recensés, qui ne sont pas exhaustifs, doivent être relativisés. Ils apparaissent effectivement modestes à court terme et très inférieurs aux avantages que la société et l’économie régionales retirent des progrès de l’intégration. L’expérience vécue par l’Union dans les années 1980 tout autant que les grandes vicissitudes récentes de l’Europe incitent toutefois à la prudence. Le renforcement de tous les acteurs économiques et financiers et l’adoption par eux de comportements vertueux, imposés si nécessaire par des règles contraignantes mais justifiées, économiseront beaucoup de difficultés et seront de précieux atouts pour réaliser les performances qui sont attendues de l’UEMOA.
Paul Derreumaux