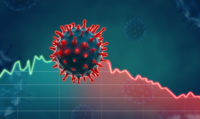Peut-on trancher les nœuds gordiens qui rendent pérennes les turbulences frappant l’Afrique Subsaharienne (ASS), malgré toutes les actions menées depuis des décennies, et libérer ainsi, enfin, son potentiel ? ll faudrait pour cela revoir certaines stratégies, en s’appuyant sur quelques évidences
Le développement économique est dans chaque pays la résultante de l’œuvre de trois acteurs qui cohabitent et doivent coopérer dans le respect de buts communs : l’Etat et ses démembrements, les entreprises privées, et les partenaires étrangers. Comme dans toute action commune, la responsabilité des échecs est toujours partagée. En revanche, le rôle des deux acteurs nationaux est prépondérant puisque ce sont eux qui mettent en œuvre toutes les actions, même émanant d’appuis extérieurs. Parmi ces deux intervenants locaux, l’Etat dispose des moyens les plus vastes, qui concernent à la fois le cadre institutionnel et administratif, les règles de fonctionnement du secteur privé et les conditions de vie des populations. Les performances de l’économie et de la finance sont donc indissociables de celles du politique, et les faiblesses de ce dernier sont la plupart du temps en mesure de ralentir, voire bloquer, les progrès des premières. Les turbulences, anciennes comme nouvelles, de plus en plus entremêlées, sont de plus en plus difficiles à éliminer. Elles exigent selon les cas d’importants moyens financiers à mobiliser, ardus à trouver en cette période troublée, ou des mutations de comportement, qui ne peuvent s’opérer que dans le moyen et le long terme. Face à ces contraintes, il semble opportun de prioriser les actions les moins complexes et ayant le maximum d’effets directs et indirects. Enfin, il est essentiel de retenir à l’esprit que l’ASS est de plus en plus hétérogène : cette pluralité rend peu efficace des solutions globales, qui traduisent un dogmatisme intellectuel, et exige plutôt une adaptation optimale à chaque cible visée. Il devrait en résulter des actions de taille souvent plus modeste mais plus efficaces et dont les résultats positifs pourraient être ressentis plus vite. Quatre exemples, non exhaustifs, peuvent être donnés de telles nouvelles approches, dont la mise en œuvre peut être combinée pour un maximum d’efficacité
Un premier changement crucial serait que les Pouvoirs Publics nationaux et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) donnent tous une priorité plus marquée à l’économie. Celle-ci est trop souvent passée au second plan par rapport au politique, empêtré dans de nombreuses faiblesses, et les nations qui ont réussi à construire, voire ébaucher, une vision économique à long terme de leurs pays, semblent progressent le plus vite. Un travail un salaire, une activité, la moindre embellie du pouvoir d’achat sont aussi ce qui change la vie au quotidien des citoyens les plus pauvres, leur restitue l’espérance en l’avenir et l’adhésion aux efforts demandés. Deux domaines au moins sont ici susceptibles d’impacts décisifs. Le premier concerne le secteur primaire : agriculture, élevage, sylviculture, pêche. Ces activités représentent déjà une part essentielle du Produit Intérieur Brut (PIB) et des emplois des pays de l’ASS -respectivement près de 20% et plus de 50% en 2020- mais les produits de rente ont surtout bénéficié jusqu’ici de toutes les attentions. Les atouts naturels sont puissants pour de plus grandes ambitions : terres cultivables, disponibilités en eau, climat souvent favorable, population croissante. Celle-ci constitue d’ailleurs pour les paysans un moteur suffisant pour augmenter régulièrement les productions vivrières grâce aux engrais et aux extensions de surface. Mais, pour gagner en puissance et en modernité, cette agriculture doit changer de méthodes et de dimension en étant plus productive et plus soucieuse de l’environnement. Les paysans ont besoin de formation, de financement, d’équipements, d’innovations, de capacité de négociation, de moyens de stockage, de modes de transport sécures et d’informations fiables. Des partenaires potentiels, pays et/ou entreprises, existent dans tous ces domaines, comme en France qui compte de grands spécialistes mondiaux, avec des réalisations déjà opérationnelles dans la production ou dans la recherche. Ceux-ci pourraient se voir accorder le droit de prendre en charge directement ces investissements, tout en y associant des producteurs et chercheurs locaux. Par souci d’efficacité, il conviendrait de privilégier les projets de taille petite ou moyenne, des technologies bien éprouvées plutôt que d’avant-garde, des matériels robustes et adaptés plutôt que trop sophistiqués, des interlocuteurs rassemblés en coopératives et associations plutôt que des individualités, un accent mis sur les réalisations plutôt que sur les études. Partout les bonnes volontés locales sont disponibles et l’enjeu d’une telle révolution, qui donnerait à l’ASS une moindre dépendance alimentaire et économique, s’est récemment aiguisé à la suite de la crise ukrainienne.
Un second créneau économique prioritaire devrait être celui des petites et microentreprises tournées vers une formalisation. Classiquement incluses dans le « fourre-tout » du secteur informel, elles en forment en catégorie à part grâce à leur capacité d’écoute et d’ouverture aux partenariats. Elles manquent de tout- argent, connaissances, matériel-, mais leurs promoteurs et promotrices débordent d’une énergie et d’une ténacité admirables. Le taux de mortalité de ces sociétés est élevé, comme dans tous les pays du monde, mais de nombreuses résistent et certaines grandissent. Face aux faiblesses des autres composantes des systèmes économiques africains, elles sont en ASS un levier efficace pour créer de la valeur ajoutée, des emplois, du pouvoir d’achat et un peu moins de dépendance extérieure. Les instruments apparaissent partout pour aider à franchir les premières étapes : des incubateurs dispensent les formations de base et encadrent les responsables, des « business angels » consentent les premiers financements, des sociétés locales de capital risque abondent les fonds propres. Certains PTF sont passés du stade du discours bienveillant à celui de l’action, soit en coopération avec les Etats qui ont compris l’importance du secteur, soit de manière autonome comme le Danemark le fait avec brio au Mali depuis plusieurs années. Les effets individuels sont certes minimes à cause de la petite taille des cibles, mais le nombre élevé de celles-ci compense cet aspect et les coûts sont modestes à côté de certains programmes dispendieux. Dix millions d’EUR d’argent public prêtés suffiraient pour aider à la croissance de 1000 micro-entreprises ayant démarré avec leurs propres forces, réaliser 50000 embauches, faire mieux vivre 500000 personnes et engendrer 3 fois plus de nouveau PIB, tout en étant ensuite réemployés vers d’autres bénéficiaires. Il resterait ensuite aux banques à prendre le relais des financements et aux Etats à ne pas les tuer par une fiscalité asphyxiante.
L’amélioration du fonctionnement et de l’atteinte des objectifs des administrations peut constituer une deuxième opportunité à court terme en visant notamment deux objectifs. L’un serait de « booster » les recettes internes des Etats, qui peinent à atteindre le seuil de 20% des PIB nationaux, sans décourager l’expansion des activités productives. Avec un plancher souhaitable pour ce ratio de 25% du PIB, les efforts nécessaires sont considérables mais plusieurs pistes existent en la matière pour enclencher une augmentation progressive. La digitalisation des administrations pour le recouvrement des impôts et taxes douanières et l’identification de la matière taxable est une réforme essentielle, normalement indolore pour les citoyens Elle est déjà pratiquée avec succès par divers pays et peut aisément être financée partout en ASS. Elle est synonyme de réduction d’insécurités sur la qualité des informations et la fraude à subir, et donc d’accroissement des entrées fiscales. Elle peut d’ailleurs être étendue avec les mêmes ambitions à d’autres aspects sensibles, allant du cadastre foncier à la paie des fonctionnaires. Une autre voie consisterait à élargir la matière taxable sans que cette évolution soit préjudiciable à la croissance : la taxation des transactions et des plus-values foncières, la mise au point d’un impôt forfaitaire sur les entreprises du secteur informel prenant en compte des moyens d’évaluation du chiffre d’affaires et du résultat seraient deux exemples de régimes fiscaux plus modernes et équitables, qui pèseraient moins exclusivement sur le secteur formel. Une troisième orientation, plus innovante, viserait à mettre en oeuvre certains programmes prioritaires en coopération directe avec des bailleurs de fonds et des acteurs privés nationaux, dont la participation pourrait être une alternative à une fiscalité supplémentaire. Les actions menées y gagneraient sans doute une accélération et une vision plus pragmatique. L’enseignement et la formation professionnelle pourraient être des secteurs-tests de cette approche, avec une délégation limitée dans le temps et l’espace et un contrôle des Etats. Le risque financier de ces initiatives audacieuses serait maîtrisé tandis que le résultat pourrait être aisément apprécié par la population et les entreprises, bénéficiaires directs de telles actions.
L’exploitation maximale de tous les avantages des solidarités régionales est une autre idée-force pour renforcer le rôle positif des Etats et combattre certaines tendances actuelles de déconstruction de ces synergies. Plusieurs directions sont utilisables. La plus urgente est celle de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, notamment dans la zone du Sahel. Les enseignements de la décennie écoulée montrent qu’une riposte efficace doit allier réponse militaire et accélération du développement, d’une part, et être commune à tous les pays concernés, d’autre part. Cela suppose des actions militaires coordonnées sous une direction unitaire et crédible, des objectifs clairs et agréés par tous, des moyens financiers accrus, des dispositifs techniques adaptés, une évaluation périodique des résultats. Un tel dispositif est difficile à mettre en œuvre mais il peut être installé progressivement et devrait recevoir le soutien d’alliés étrangers à la zone concernée. Un autre progrès pourrait résider dans la fixation de délais restreints pour la transposition au niveau national de décisions prises par un collectif d’Etats, dans le cadre d’une structure permanente comme dans des circonstances particulières : en l’absence d’une telle règle, l’Afrique a connu dans le passé beaucoup de retards dans la transposition nationale de nouvelles mesures utiles pour tous, en particulier pour les législations fiscales et douanières ou certaines politiques économiques. Enfin, dans le même esprit, les membres d’une Union régionale pourraient confier à des institutions « ad hoc » la réalisation d’investissements prioritaires d’envergure régionale. Grâce à ce transfert ponctuel, volontaire et contrôlé de souveraineté, comme il l’a été recommandé ci-avant, cette méthode devrait être avantageuse en rapidité d’exécution, en cohérence, en économie de coûts et en pertinence par rapport aux besoins, et pourrait servir d’incitation à d’autres solidarités.
Le troisième revirement stratégique devrait toucher les interventions des partenaires étrangers en faveur du développement de l’ASS et les attentes sont nombreuses. D’abord, une meilleure écoute des besoins réels. La définition d’un projet ou d’un programme d’actions s’ajuste encore davantage aux préoccupations du partenaire qu’aux besoins réels des groupes destinataires du pays receveur. Les partenaires ont même tendance à harmoniser leurs positions, en se regroupant dans de nouvelles structures qui viennent s’ajouter au « mille-feuilles » administratif existant, ce qui renforce encore leur force de négociation. L’Alliance Sahel, émanation des pays de l’Union Européenne au bénéfice de cette zone, la toute nouvelle Alliance pour l’Entrepreneuriat en Afrique regroupant des institutions multi- et bilatérales, sont des avatars récents de cette tentation. Si la coordination entre partenaires au développement est bien nécessaire, elle ne devrait pas être effectuée de manière unilatérale, mais regrouper pour chaque projet les bailleurs, les destinataires appréhendés sous la forme la plus pertinente et les Etats hôtes. Le changement est d’autant plus nécessaire au moment où la compétition internationale entre grands blocs rivaux, voire ennemis, prend parfois en otage les pays demandeurs de l’ASS et où l’Afrique devient de plus en plus plurielle.
En second lieu, l’acceptation par tous les bailleurs de fonds publics d’un dialogue direct avec les utilisateurs finals de l’aide. Le canal de l’Etat hôte était jusqu’il y a peu le seul admis. Une plus grande liberté commence à apparaitre, qui n’exclut pas le suivi par l’Etat des programmes engagés : elle devrait conduire à des résultats probants, en termes de coûts, de délai de décision et d’efficacité, qui faciliteront l’extension de cette procédure indispensable, Le programme de financements mis en place au Mali par le Danemark pour les petites entreprises, cité ci-avant, suit cette voie plus directe.
La réduction de la taille de la plupart des projets ensuite : les années passées ont coïncidé avec la hausse importante de l’envergure minimale des projets considérés comme acceptables, sous la justification notamment des coûts d’analyse Cette tendance conduit à des excès à corriger : le lancement effectif des actions, l’évaluation de leurs effets et les éventuelles corrections de trajectoires ne devraient qu’en être plus faciles. La réduction des délais de lancement effectif et de décaissement des fonds mobilisés constitue d’ailleurs une difficulté substantielle : les durées de préparation imposées par les PTF sont anormalement longues, souvent injustifiées et entrainent des surcoûts qui peuvent aller jusqu’à rendre impossible la réalisation de certains investissements. La Banque Africaine d’investissement (BAD) et l’Union Européenne (UE), qui auraient pourtant des raisons d’être exemplaires, sont hélas parmi les plus mauvais exemples en la matière.
Une dernière réforme devrait résulter du constat que l’Afrique évolue de plus en plus à -au moins- deux vitesses avec des différences croissantes entre Etats, et que les appuis donnés, par un souci logique et équitable de rééquilibrage, à ceux qui ont réalisé le moins de progrès ont souvent des effets très réduits. Cette faible efficacité peut certes résulter de handicaps naturels permanents ou exceptionnels, tels les effets du dérèglement climatique. Mais elle provient la plupart du temps de la mauvaise gouvernance ou du manque de vision et de savoir-faire des dirigeants des pays concernés. Les objectifs visés ont alors été doublement manqués. Pour éviter un telle issue, trois scénarios pourraient être alors simultanément menés. Le premier consisterait à consentir plus de soutiens aux nations qui se sont déjà engagées avec assez de détermination, de constance et d’organisation sur le chemin du développement économique, afin de maximiser les chances d’obtenir les résultats les plus rapides et les plus « impactants » pour les nouveaux soutiens apportés. Ces concours pourraient d’ailleurs être de plus en plus consentis sous forme de prêts Le deuxième périmètre pourrait viser les pays les moins favorisés, voire les plus réfractaires aux changements, pour éviter de laisser les populations concernées s’enfoncer dans une pauvreté accrue : la condition posée pour ces appuis, composés principalement de dons ou de prêts très bonifiés, pourrait être une intervention directe auprès des utilisateurs finals afin d’apprécier au mieux les résultats obtenus. La troisième consisterait à renforcer particulièrement les programmes des Structures régionales et rejoint le levier déjà évoqué de restitution d’un rôle important à ces regroupements de pays.
Un quatrième facteur d’accélération concerne les institutions financières, et notamment les banques commerciales. Partout sur le continent, celles-ci ont renforcé leurs structures, développé leur puissance et consolidé leur rentabilité depuis les crises systémiques des années 1970/80. La hausse notable de leurs fonds propres et la sévérité progressivement durcie des régulations qu’elles doivent suivre expliquent cette évolution. Grâce à ces nouveaux atouts, le poids relatif des concours bancaires à l’économie dans le PIB approche en moyenne dans l’ASS 40%. Ce taux reste cependant faible par rapport aux autres régions en développement et est très inégal, dépassant les 100% en Afrique du Sud et demeurant en deçà de 20% dans diverses nations. De plus, ce taux recule parfois, comme cela a été le cas dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) depuis 2018, sous l’effet de la réaction des banques à de nouvelles contraintes réglementaires ou à des opportunités attractives de placements de trésorerie.
Il faut donc accentuer toutes les actions de réorientation des institutions bancaires vers le financement des crédits à l’économie. Plusieurs leviers sont envisageables en la matière : nouvelles incitations réglementaires par le jeu des provisions de fonds propres demandées sur certains secteurs ; allègements fiscaux contrôlés et limités au profit des crédits consentis à des créneaux d’activités névralgiques ou spécialement difficiles. Mais l’instrument le plus efficace continue à être le partage avec d’autres acteurs des risques encourus pour ces concours. Cette pratique est déjà mise en oeuvre depuis longtemps par diverses institutions telles, par exemple, Proparco ou la Société Financière Internationale. Mais la pratique doit être largement intensifiée et généralisée, aussi bien par les institutions multilatérales et bilatérales d’appui au développement que par des structures nationales. La Côte d’Ivoire vient ainsi de créer un Fonds de Garantie pour les PME qui devrait répondre à cet objet et rejoint les initiatives déjà prises par d’autres nations. Il s’agit sans doute là de la meilleure arme pour développer au maximum les concours à ces catégories d’entreprises, dont la réussite du plus grand nombre ouvrira pour les pays de l’ASS les portes d’une consolidation radicale de leur appareil économique.
Pour les entreprises figurant dans la partie inférieure de l’éventail existant et disposant d’un grand potentiel, de nouveaux instruments se mettent aussi en place comme il l’a été souligné ci-avant. Ainsi la société I§P, dont les fonds d’investissement locaux seront bientôt implantés dans une dizaine de pays, tant francophones qu’anglophones, est un des pionniers de ce modèle. Pour des sociétés encore plus petites, l’association ABAN, qui oeuvre avec l’appui de la Banque Mondiale, coordonne maintenant une soixantaine de « business angels » souvent entièrement privés. Le Mali en compte désormais un depuis un an, MALI ANGELS, fort modeste mais prometteur dans un environnement difficile.
Ces quelques exemples sont bien sûr très partiels. Ils laissent en particulier de côté le grand chantier qui doit viser la puissance publique, pouvoirs politiques et administratifs confondus, là où s’est le plus développée une mauvaise gouvernance dont la protubérance est parfois capable de maintenir un pays dans un immobilisme mortifère. La puissance de cette turbulence requiert certes une urgence absolue, l’action conjuguée de tous les autres acteurs au développement et l’utilisation de tous les leviers possibles. Mais les effets espérés ne seront pour la plupart visibles qu’à moyen terme en raison de la complexité des blocages et de la nature des moyens d’action. La mise en œuvre efficace des mesures présentées ci-avant et les résultats qui pourraient en être attendus à court terme pourraient faciliter l’atteinte de cet objectif central.
Paul Derreumaux
Article rédigé le 30/05/2022