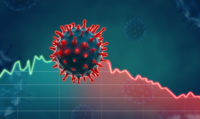Systèmes bancaires dans l’UEMOA : Mention bien face à la crise
Le constat est encourageant. Au vu des Assemblées Générales qui s’égrènent des banques cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le système financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a bien résisté, dans l’ensemble, aux conséquences économiques et sanitaires de la crise du Covid-19. Une analyse plus fine met toutefois en évidence trois constats plus précis : une gestion plutôt efficace des banques, un contexte favorable dans l’Union, des incertitudes à attendre en 2021.
Les principaux indicateurs de l’année 2020 montrent d’abord les bonnes capacités d’adaptation des systèmes bancaires à cette situation inédite. Au plan des charges de fonctionnement, le secteur a été de ceux qui ont le mieux appliqué les consignes sanitaires liés à la pandémie -distanciation, généralisation du télétravail- et les équipes ont été assez peu touchées par le Covid-19. Les coûts supplémentaires qui en ont découlé ont été souvent compensés par les mesures d’économie prises en 2020 : restrictions de voyages, mises en chômage partiel, ajournement de recrutements. Les charges d’exploitation ont ainsi connu une hausse limitée, et parfois un repli pouvant approcher 10% du total pour les banques les plus économes.
Au plan des activités, la plupart des banques ont enregistré une progression plus soutenue de leurs ressources de clientèle que de leurs concours à l’économie. La première traduit les efforts des entreprises et des ménages de constitution d’encaisses de précaution dans un contexte de baisse des activités et d’attentisme des investissements. En Côte d’Ivoire, la croissance moyenne des dépôts de la place a été ainsi de 24% sur l’année. Dans les autres pays, des performances comparables ont été atteintes : + 17% pour l’ensemble du Groupe Orabank, + 26% pour la Banque Malienne de Solidarité, + 22% pour la BANK OF AFRICA au Burkina Faso par exemple, Les crédits directs en fin de période ont au contraire réduit leur progression du fait du freinage général des échanges internationaux, du ralentissement des économies, mais aussi de la prudence redoublée des banques dans la distribution de nouveaux concours. En Côte d’Ivoire, le total des crédits a progressé de 14%, provoquant un recul de 7% du taux de réemploi des ressources. Dans le Groupe BANK OF AFRICA, les crédits de trésorerie n’ont augmenté que de 5% au Burkina Faso et au Sénégal, et se sont mêmes repliés en valeur absolue au Mali.
Au plan des résultats, les Produits Nets Bancaires (PNB) sont souvent restés proches des niveaux records de 2019 : malgré la tendance au recul des commissions pénalisées par le manque d’affaires nouvelles, les marges d’intérêt ont été préservées, grâce notamment à une fréquente réorientation des concours à la clientèle vers des placements en trésorerie peu risqués, et ont sauvé l’essentiel. Cette résistance a été notée dans tous les pays de l’Union, avec dans chacun d’eux des situations variables des établissements en fonction de leur portefeuille de clients, de leur appétence aux risques et de leur capacité de trouver des emplois alternatifs. La situation est plus disparate pour les Résultats Bruts d’Exploitation, en raison de l’impact des politiques variables suivies dans la gestion des charges courantes, et pour les Résultats Nets. Ceux-ci portent notamment la trace du coût du risque : ce dernier a bien sûr généralement grandi à compter du second semestre 2020. Mais, derrière cette constante, l’impact final a souvent été atténué par l’habileté des équipes à proposer des restructurations acceptables. Les bénéfices dégagés sont donc fréquemment supérieurs à ceux de 2019, comme c’est le cas pour Ecobank Cote d’Ivoire ou Corisbank, ou en repli limité, telle la SGCI, première banque de l’Union. Quelques établissements ont réussi des parcours remarquables, comme Bridge Bank à Abidjan dont les dépôts et les crédits ont crû respectivement de 26% et 17%, qui a atteint ses objectifs budgétaires et dont le bénéfice annuel a fait un bond de 30%. Dans tous les cas, les banques dont les résultats sont déjà publiés distribueront des dividendes voisins, et parfois supérieurs, à ceux de 2019.L’année 2020 n’aura donc pas été ici une année de crise pour le secteur.
Deux principales causes extérieures ont favorisé cette résistance des banques de la région. La première est l’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Union en 2020 (+0,9%), meilleure que celle de l’ensemble l’Afrique subsaharienne, en recul de plus de 4%. L’absence de confinement généralisé dans l’espace régional, la force des circuits informels, la forte chute des prix du pétrole dont la zone est globalement importatrice expliquent largement cette bonne tenue macroéconomique. Dans plusieurs pays, les entreprises ont aussi bénéficié des actions de l’Etat pour soutenir leur appareil économique ou instaurer des protections sociales exceptionnelles : création de fonds de soutien aux entreprises, notamment de petite taille, report d’échéances fiscales, paiements de « packages » de secours aux populations les plus vulnérables. Dans ces circonstances, elles ont été mieux armées face à la pandémie et les banques en meilleure position pour éviter les déclassements de dossiers.
Surtout, l’Union a été favorisée par une réaction rapide et efficace de la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à travers deux types de mesures. La première est réglementaire, pour alléger en cette période les contraintes pesant sur les banques en la matière : report possible à court terme d’échéances des crédits, sans déclassement de ceux-ci ; baisse des taux pour les adjudications de ressources aux banques ; décalage d’un an dans le durcissement des ratios relatifs aux fonds propres. La deuxième est financière avec les « Bons Covid » dont la diligence de mise en place est à saluer. Ces Bons, émis par les Etats de l’Union, ont apporté à ceux-ci des financements d’une maturité de trois mois au taux maximum de 3,5%, affectés aux mesures d’urgence, et ont été souvent un relais de concours à plus long terme des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). L’accord donné aux banques par la BCEAO pour un refinancement intégral possible de ces Bons a permis leur participation massive à la souscription et le succès de ces titres. En un an, quelque 1500 milliards de FCFA ont été ainsi levés par les Etats selon une programmation ciselée. Très opportune pour les Etats, cette initiative a aussi servi les banques dans la recherche d’emplois de substitution à faible risque et dans la préservation de leur compte d’exploitation. Elle a en revanche sans doute peu encouragé le système financier à des efforts exceptionnels vis-à-vis des entreprises en difficultés.
En dehors de l’UEMOA, ces contextes favorables ont souvent manqué, et les résultats des banques s’en ressentent en de nombreux endroits. En Afrique Centrale francophone, le plongeon des cours de l’or noir a provoqué un net recul des PIB des pays concernés : celui-ci a pesé sur les ressources de clientèle, réduit drastiquement les possibilités de crédit et multiplié les exigences de provisions pour créances en souffrance. Au Kenya, dont le système bancaire est un des plus performants d’Afrique, la crise a été multiforme ; recul de secteurs essentiels comme le tourisme ou l’agriculture, hausse du déficit budgétaire et de la dette extérieure, baisse des flux financiers de la diaspora. Il devrait en résulter pour les banques une hausse sensible des provisions et une nette baisse des bénéfices : – 22% pour la Kenya Commercial Bank, – 42% pour le nouveau groupe National Commercial Bank of Africa (NCBA).
Pour 2021, les perspectives demeurent mitigées. Depuis le deuxième trimestre 2020, les Etats africains ont certes, avec des fortunes diverses, mis en place des parades à la crise économique issue de la pandémie et les appareils économiques ont appris à fonctionner face à celle-ci. Cependant, les appréciations les plus fréquentes tablaient sur un retour à la normale début 2021 et un plein « effet de rattrapage » pendant l’année en cours. Les estimations sont désormais moins optimistes. En Afrique comme ailleurs, beaucoup de nations ont été frappées par une deuxième ou une troisième « vague » de l’épidémie, parfois plus contagieuse ou mortelle, imposant de nouvelles restrictions et freinant la reprise de l’économie. Le rythme de celle-ci est donc encore incertain et le retour à la situation de fin 2019 plutôt reporté désormais à 2022. Si certains secteurs cruciaux pour le continent se portent mieux, comme le pétrole où le niveau d’équilibre actuel est meilleur pour les vendeurs et acceptable pour les acheteurs, des pans entiers comme le tourisme et l’hôtellerie sont encore en souffrance. Des dangers issus de la crise de 2020 restent menaçants. Ils sont macroéconomiques tels les déficits budgétaires fortement gonflés sans espoir de retour à la normale à court terme, un endettement public en hausse généralisée, une croissance du PIB intérieure aux précédentes anticipations, une forte inflation importée pour certains produits. Ils sont aussi microéconomiques avec le risque de faillites d’entreprises plus nombreuses après l’arrêt des aides de l’Etat là où elles existaient et la tentation de certains gouvernements à renforcer la pression fiscale pour résorber les lourds déficits budgétaires.
Dans ce paysage incertain, la zone UEMOA devrait être encore plutôt favorisée. Les dernières prévisions des Autorités régionales retiennent une hausse du PIB de 5,8% en 2021, légèrement supérieure à celle de 2019 et en progrès par rapport aux premières estimations faites en début d’année Emmenée notamment par les bonnes perspectives de la Cote d’Ivoire, « poids lourd » de l’Union, cette progression devrait être assez bien répartie dans les 8 pays de l’UEMOA. Elle serait surtout une nouvelle fois sensiblement supérieure aux résultats moyens de l’Afrique subsaharienne -où une avancée de 3,4% du PIB est escomptée- et permettre la reprise d’une progression du revenu par habitant. Le niveau encore tolérable de l’endettement public, malgré les emprunts contractés en réponse à la crise, en comparaison avec celui de nombreux autres pays africains va constituer un autre atout de la zone. Il devrait être complété par une réduction du déficit budgétaire grâce à la réduction des aides exceptionnelles et la reprise économique.
Ce contexte favorable devrait bénéficier à nouveau globalement au système financier de l’UEMOA. En termes d’activité, une tendance positive, pour les dépôts de clientèle et pour les crédits à l’économie, en lien avec les améliorations macro-économiques, pourrait être ressentie par tous les établissements. En termes de résultats et de profitabilité, l’éventail des situations pourrait être plus large en fonction notamment des politiques suivies par les établissements en 2020 : importance suffisante des efforts de provisionnement et de restructuration des crédits fragiles, intensité des réformes de fonctionnement consenties, niveau des fonds propres après la crise. Sans surprise, ceux qui auront suivi les trajectoires les plus rigoureuses en 2020 seront les mieux armés pour la suite. Les transformations du système financier régional se poursuivent d’ailleurs, annonçant de vraisemblables repositionnements : le groupe BNP continue son repli stratégique et a cédé ses filiales burkinabé et malienne ; cette dernière a été reprise par Atlantic Financial Group, présent désormais dans 4 pays ; Bridge Bank Cote d’Ivoire ouvrira sa succursale sénégalaise en septembre prochain, la BMS malienne rêve d’un troisième site dans l’Union et de suivre les traces de la BDM. Le clan des « outsiders » se renforce donc, promettant de nouvelles confrontations intéressantes pour les années à venir.
Paul Derreumaux
Article publié le 10/05/2021