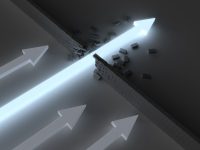Démographie : tendances mondiales, contrastes africains
La population mondiale augmente toujours à vive allure, mais sa répartition géographique poursuit également de profondes transformations. Dans ces changements globaux, l’Afrique tient une place croissante. Pourtant, les données démographiques du continent traduisent autant de défis que d’atouts.
La démographie est une des rares sciences sociales où il est possible de prévoir l’avenir, même à l’horizon de 30 ans, avec de bonnes chances d’être proche de la vérité future. Les mouvements démographiques sont en effet difficiles à modifier et leur réorientation ne peut souvent s’observer qu’à l’horizon minimal d’une ou deux générations, ce qui est du véritable long terme au plan économique. Les statistiques que le « Population Reference Bureau » (PRB) a récemment publiées sur la population mondiale en 2013 et sur les estimations d’évolution jusqu’en 2050 confirment cet état de fait. Elles s’inscrivent en effet dans les prévisions précédemment parues tout en mettant à jour diverses nouvelles inflexions.
Au plan global, la poursuite d’une forte croissance, la profonde modification de l’équilibre entre continents et l’urbanisation croissante restent les trois évolutions majeures, mais de nouvelles tendances apparaissent. La population mondiale devrait croître de 40% sur la période, passant de 7,1 milliards d’individus en 2013 à 8,1 milliards en 2015 et 9,7 milliards en 2050. Cette évolution est supérieure aux prévisions antérieures et l’humanité ne plafonnera donc normalement pas aux quelque 9 milliards de personnes un moment annoncées. Toutefois, l’inflexion à la baisse de la courbe de croissance s’observe dès 2025 et devrait s’accentuer après 2050. L’indice synthétique de fécondité est désormais inférieur 2,2 sur tous les continents, à l’exception de l’Afrique où il s’élève encore à 4,4. Cet indice, principal indicateur de la capacité de renouvellement des générations, a même plongé en deçà de 2 en beaucoup d’endroits et enregistre notamment ses minimaux, voisins de 1,5, en Europe, en Chine et au Japon. Ces fortes variations expliquent que le mouvement de répartition de la population entre continents, entamé de longue date, s’accentue encore. Sur les 35 prochaines années, la population européenne restera stable, mais celles de toute l’Europe de l’Est, d’Espagne et de Grèce devraient reculer de 10%. Dans le même temps, l’Asie, toujours largement dominante, verrait son poids relatif se réduire de 60% à 54% : la stabilisation de la Chine aux environs de 1,35 milliard de personnes et le repli de 20% de la population japonaise pèsent lourdement sur cette évolution. La forte croissance de l’Inde, qui serait en 2050 la nation la plus peuplée avec 1,65 milliard d’habitants, est la principale cause de la prééminence que garderait le continent asiatique.
Comme prévu, l’urbanisation va s’intensifier sur la période à venir. La part de la population urbaine, qui atteint déjà 52% du total, en représentera sans doute dans une génération plus de 55%. Cette tendance ne connait d’exception en aucune partie du monde : elle est seulement plus marquée dans les pays du Sud sous le double impact de la pression démographique et d’un exode rural plus intense. En 2011, 30 villes comptaient déjà plus de 9 millions d’habitants et, en 60 ans, les mégalopoles des pays industrialisés sont devenues minoritaires face à celles des pays du Sud. L’Inde est à ce jour la seule nation à avoir deux cités de plus de 20 millions d’habitants
Dans ce monde en évolution, l’Afrique reste une exception à bien des égards. Dépassant toutes les estimations précédentes, l’accroissement désormais annoncé serait de 33% jusqu’en 2025 puis de 66% ensuite, soit une augmentation totale de 120% portant la population à 2,4 milliards au milieu de ce siècle, soit 24,9% de la population mondiale contre 15,4% aujourd’hui. Pour la seule Afrique subsaharienne, la population serait multipliée par 2,4 et approcherait les 2,2 milliards d’habitants. Cette progression est en bonne part le résultat du maintien d’un indice de fécondité très élevé et désormais très éloigné de ceux des autres parties du monde : 4,8 pour le continent ; 5,2 pour sa seule région subsaharienne. Les dix pays où cet indice est supérieur à 6, sont désormais tous africains et le Niger, qui détient présentement le record avec un taux de 7,6, connait même une accélération de sa croissance démographique. Sur le continent, seuls les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique Australe ont réalisé ou largement entamé leur transition démographique. Ailleurs, la population augmentera d’environ 150% d’ici à 2050. Sous cette poussée, le Nigéria – avec 440 millions de personnes -, la République démocratique du Congo (RDC) et l’Ethiopie deviendront respectivement la 3ème, la 9ième et la 10ème nation du monde par leur population avant le milieu de ce siècle, tandis que trois autres pays du continent pèseraient à cette date plus de 100 millions d’habitants. Deux grands blocs confirmeront leur puissance démographique à cet horizon : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) avec près de 270 millions d’habitants et, surtout, l’East African Community (EAC) dont les 5 pays approcheraient un total de 400 millions d’individus.
Une autre particularité africaine est celle d’une urbanisation en retard par rapport aux autres continents. Avec un taux de 40% en 2012 -37% pour la seule partie subsaharienne -, l’Afrique demeure loin derrière l’Asie, où ce taux est de 46%, tandis qu’en Amérique et en Europe plus de sept personnes sur dix habitent les villes. Même si l’augmentation de ce ratio est indéniable, il n’est pas certain que le seuil des 50% sera atteint par les urbains avant 2050. Le poids démographique de la zone Est, où ce taux d’urbanisation ne dépasse pas encore les 25%, freinera en effet l’évolution d’ensemble. La place des mégalopoles confirme cette occupation différente de l’espace : face aux 16 villes de plus de 9 millions d’habitants en Asie à ce jour, l’Afrique ne compte que Lagos et Le Caire à franchir ce nombre.
Cette population africaine est la plus jeune du monde. Il est en effet estimé qu’en moyenne les moins de 15 ans sont actuellement quelque 41% du total – contre 26% sur la planète – et dix fois plus nombreux que les plus de 65 ans, qui rassemblent seulement 4% de l’ensemble. Une telle structure par âges va permettre à la population active du continent de poursuivre sur les trente prochaines années une croissance de son poids relatif, situation qui va disparaitre ailleurs. Ces spécificités apportent à l’Afrique des atouts mais aussi des challenges : à court terme, de lourds besoins en investissements en matière d’éducation mais aussi de grandes potentialités pour une forte croissance de la production ; à moyen et long terme, d’immenses marchés de consommateurs mais la nécessité de créer des emplois à la dimension d’une offre de main d’œuvre en progression vive et prolongée.
Plusieurs indicateurs socio-démographiques illustrent par ailleurs la gravité du retard économique et social de l’Afrique. Le taux de mortalité infantile dépasse encore de près de 75% la moyenne mondiale : respectivement 68‰ et 40‰, l’Afrique francophone se démarquant par les chiffres les plus défavorables. L’espérance de vie, en progrès, s’élève maintenant à 59 ans, et 56 pour l’Afrique subsaharienne, alors qu’elle atteint désormais 70 ans pour la moyenne mondiale et même 83 ans au Japon. L’accès à l’assainissement dépasse à peine 54% et se limite à 42% dans les pays subsahariens, contre 79% en moyenne mondiale, pour ce qui concerne les parties urbaines. Il plonge respectivement à 31% et 24% dans les zones rurales, où le taux mondial avoisine les 46%. Par rapport aux pays du Nord, le VIH-Sida touche une proportion de la population 7 fois plus importante sur le continent, et plus de 10 fois pour la seule Afrique subsaharienne, où il apparait en forte croissance, spécialement en Afrique Australe. L’analyse par revenu met enfin en évidence de fortes inégalités puisque les 10% les plus pauvres de la population possèdent quelque 6% du revenu national alors que les 10% les plus riches en détiennent 48% : moins accentués qu’aux Etats-Unis, ces écarts le sont davantage qu’en Europe et illustrent une des lacunes de la croissance africaine. Le croisement de certains indicateurs montre d’ailleurs une aggravation de ces tendances générales : dans de nombreux pays, un important écart existe par exemple pour l’indice de fertilité, déjà exceptionnellement élevé, entre les groupes les plus aisés et ceux dont le revenu est le plus faible. Au plan géographique, seuls les pays de la zone Australe, emmenés par l’Afrique du Sud, apparaissent en avance notable sur divers indicateurs, grâce à leur développement économique plus marqué, mais les inégalités y sont aussi nettement plus fortes.
La puissance démographique croissante de l’Afrique et les données qui la caractérisent ou en découlent peuvent donc être aussi perçues comme le reflet immédiat des faiblesses du combat pour le développement. Les statistiques collectées mettent notamment en évidence la forte interaction entre démographie, culture et économie. Les progrès de la médecine se propagent plus vite que ne le font les changements de mentalités. La rationalité économique qui expliquait les grandes familles n’a pas été relayée jusqu’ici par une nouvelle rationalité qui justifierait la réduction significative du nombre d’enfants pas ménage. La poussée de l’urbanisation semble résulter davantage de l’espoir d’un meilleur accès aux services sociaux de base que de l’attente d’un hypothétique emploi stable. Les caractéristiques présentes de la croissance économique en Afrique subsaharienne, telles qu’elles sont observées aujourd’hui, s’accommodent, voire favorisent, une accentuation des inégalités financières et sociales qui pénalisent elles-mêmes l’introduction d’un développement plus performant en termes de création d’emplois et l’amélioration des indicateurs sociaux. Divers cercles vicieux viennent ainsi freiner la propagation des effets positifs d’une croissance soutenue mais qui ne touche encore que quelques secteurs. Pour briser ces cercles, il faut agir vite, avec courage, lucidité et solidarité. Autant de qualités qu’il est difficile de rassembler, en Afrique comme ailleurs.
Paul Derreumaux